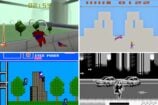Cela a beau être rare, c’est néanmoins arrivé de nombreuses fois au cinéma lors de ces dernières décennies. Nous avons donc sélectionné plusieurs longs-métrages qui marquent les débuts de metteurs en scène aujourd’hui reconnus. Si la plupart d’entre eux connaîtront par la suite d’immenses succès, ces « premiers jets » représentent parfois la quintessence de leur parcours.
N.B : La liste choisie regroupe des réalisateurs généralement appréciés dans l’univers geek, mais de nombreux autres exemples existent. Comment ne pas penser par exemple à 12 hommes en colère de Sydney Lumet ou encore au Citizen Kane de Welles. N’hésitez donc pas à partager vos trouvailles avec nous. Mais attention, il doit s’agir d’une première œuvre (ou presque) !
[nextpage title=”Les premiers…”]
Duel de Steven Spielberg (1971)
Malgré sa longue carrière, Steven Spielberg a très vite tapé dans l’œil des studios. Duel est son premier gros succès, et marque les débuts d’un des plus grands réalisateurs de la seconde partie du XXe siècle. Ce téléfilm, diffusé par la suite (en 1973) dans les salles, concentre déjà tout le savoir-faire de l’américain. Tourné en douze jours avec un budget dérisoire, Duel a étonné les spectateurs en leur faisant ressentir la peur de l’inconnu.
On y découvre l’histoire de David Mann, représentant en informatique devant se rendre à l’autre bout de la Californie pour un rendez-vous. Alors que le paysage ensoleillé défile sous les fenêtres de son véhicule, il est pris en chasse par un poids lourd qu’il a doublé durant sa route. Sans jamais apercevoir son visage, il comprend que le routier en a après lui. Un duel à mort s’engage alors.
Spielberg s’attaquera par la suite à des projets nettement plus importants avec Les Dents de la Mer et Rencontres du troisième type, mais Duel permet de mieux appréhender son style. Il démontre qu’avec un scénario minime, le rythme prime. C’est la science de ce dernier qui lui a toujours permis de conquérir le grand public. Le film a très bien vieilli et montre que ce « gamin » de 26 ans avait déjà compris beaucoup de choses au 7e art.
THX 1138 de George Lucas (1971)
Produit par le grand Francis Ford Coppola, THX 1138 est le premier film de George Lucas. Si le film n’a connu qu’un succès relatif à l’époque, il s’agit malgré tout d’une œuvre d’anticipation très intéressante.
Elle permet de découvrir une atmosphère finalement assez inattendue par rapport à ce que l’on connait de Lucas aujourd’hui. Sorti en 1971, il partage énormément de pistes de réflexion avec d’autres films et livres, notamment l’adaptation de 1984, chef-d’oeuvre de George Orwell.
Au XXVe siècle, alors que les hommes ne sont plus désignés que par une suite de lettres et de chiffres, un technicien ordinaire (excellent Robert Duvall) va vivre une histoire d’amour avec une femme alors que la société l’interdit. Une course contre la montre débute alors…
THX 1138 est une œuvre intéressante, car elle s’avère plus sombre que la saga Star Wars qui va suivre, et s’imposer chez tous les spectateurs pendant des décennies. On peut ainsi le percevoir comme un film plus intimiste, Lucas cultivant une atmosphère glaciale, aux antipodes de la relative candeur de la suite de son œuvre.
Reservoir Dogs de Quentin Tarantino (1992)
Huis-clos nerveux, d’où transpire toute l’énergie du jeune Tarantino, Reservoir Dogs aura durablement marqué les spectateurs. Il faut bien avouer que le réalisateur a pu compter sur un casting formidable, composé entre autres d’Harvey Keitel, Tim Roth ou Michael Madsen.
À la suite d’un hold-up raté, des braqueurs professionnels se regroupent pour comprendre lequel d’entre eux les a trahis. Il n’en fallait pas plus au réalisateur pour étaler sa célèbre recette, composée de dialogues ubuesques et de violence décomplexée. Cette brutalité enrobée de folie douce deviendra par la suite sa marque de fabrique, et se déclinera dans d’autres succès comme Pulp Fiction, Kill Bill ou Inglorious Bastards. Immanquable.
Following, le suiveur de Christopher Nolan (1998)
Pour beaucoup de spectateurs, l’excellent Memento était le premier vrai film du désormais célèbre Christopher Nolan. Following, le suiveur vaut pourtant clairement le détour. Ce film d’à peine 1 h 10 réalisé avec un budget ridicule de 6000 dollars aura tapé dans l’oeil des cinéphiles, qui verront à raison la naissance d’un talent.
Comme Spielberg et son Duel, Nolan réduit le script au maximum pour se focaliser sur l’idée principale du film. Bill est un romancier en herbe, qui décide de prendre des inconnus en filature afin de trouver de l’inspiration. Alors qu’il s’adonne à son étrange numéro, il est repéré par Cobb, un cambrioleur intelligent, mais instable, qui le persuade de réaliser des effractions à ses côtés.
Tournée en noir et blanc, Following, le suiveur est un bel hommage au film noir. Ce polar plein de malice se laisse regarder avec plaisir, porté par un quasi-inconnu (Jeremy Theobald) plutôt inspiré. On y décèle déjà un gout prononcé pour les mises en scène froides et atmosphériques, qui ne cessera de grandir par la suite.
District 9 de Neil Blomkamp (2009)

Sorti il y a un peu moins de dix ans, District 9 est rapidement devenu l’étendard d’un renouveau de la science-fiction. Réalisé par Neill Blomkamp, un jeune sud-africain de 30 ans, ce film arrive habilement à mêler les codes du fantastique et du drame social. Pas étonnant que Peter Jackson ait décidé de le produire.
Alors que des extra-terrestres se réfugient sur terre, ils sont parqués dans le District 9, un gigantesque ghetto à ciel ouvert. Ne sachant quoi faire d’eux, les Nations Unies ont décidé de déléguer la tâche à une société privée qui s’intéresse plus à leur technologie et leur morphologie qu’à leur bien-être. Alors qu’une émeute pointe, un agent de terrain chargé d’évacuer les non-humains de certains quartiers contracte un virus qui modifie son ADN et le transforme en extra-terrestre. Il devient alors extrêmement recherché, et décide de se cacher dans le District 9 auprès de ceux qu’il maltraitait autrefois.
Pour son premier long-métrage, Blomkamp marque le retour de la science-fiction intelligente. Filmé à la manière d’un documentaire, District 9 arrive à insuffler un profond réalisme social à une situation initiale pour le moins insolite.
Les aliens disposent d’un design qui les différencie clairement de notre espèce, pourtant, nous les traitons de la pire des manières. L’occasion de souligner que le temps passe, mais que nos mentalités n’évoluent pas beaucoup.
Le réalisateur continuera de travailler sur une forme d’éveil des consciences par la suite, mais les gros moyens de production US feront perdre de leur saveur à ses autres films (Elysium, Chappie). On retrouve enfin sa patte grâce à ses courts-métrages publiés sur internet via son Oats Studio.
[nextpage title=”… Mais certainement pas les derniers !”]
La Nuit des morts-vivants de George A. Romero (1968)
Alors qu’il vient récemment de nous quitter, comment ne pas évoquer George Andrew Romero et le film qui l’a fait connaitre du public. Paru en 1970, La nuit des morts-vivants aura eu un impact considérable sur le film d’épouvante et sa perception auprès du public.
Alors qu’ils vont fleurir la tombe de leur père, Barbara et Johnny sont attaqués par un homme au comportement étrange. Cette dernière parvient à s’enfuir et se réfugie dans une maison avec d’autres fugitifs comme elle. En écoutant la radio, ils apprennent que les morts s’attaquent désormais aux vivants.
C’est sur la base de ce scénario pour le moins famélique que Romero va réussir à bouleverser un genre. Sur la forme, grâce à des séquences réalistes et terrifiantes pour l’époque, mais aussi sur le fond, grâce à une parabole de l’Amérique des années 60. En créant une menace relativement nouvelle au cinéma, Romero tisse en filigrane la critique du contexte politique (et racial) du pays.
Avec un budget dérisoire, le réalisateur repousse les limites de la peur, tout en restant intelligent. Cette seconde lecture n’est bien sûr pas apparue à tous lors de la sortie du film, mais elle s’impose aujourd’hui avec une mordante évidence.
Mad Max de George Miller (1979)
Premier film de George Miller, Mad Max a tout du petit miracle. Produit avec un budget dérisoire de 350 000 dollars, le film fait rapidement parler de lui grâce à sa grande violence qui lui vaudra une importante censure… Et une sacrée réputation. Si les accusations de violence excessive font aujourd’hui sourire, on constate que le long-métrage sorti en 1979 a bien vieilli.
On y découvre une Australie apocalyptique, peuplée de motards sans merci et de policiers « Interceptor », la bataille pour le pétrole restant fait rage. L’agent Max Rockatansky tente de conserver un semblant de dignité en effectuant son travail avec soin. Mais quand sa femme est victime de ces délinquants de la route, il entre dans une rage que personne ne pourra calmer.
Âgé alors d’une trentaine d’années, George Miller montre ici un véritable sens du spectacle. Ancien médecin travaillant en salle d’urgence, l’Australien arrive à rendre plausibles les scènes gores qui parsèment le film. Mad Max contient déjà l’essence même de son cinéma : la science du rythme. Sa mise en scène coup-de-poing ne laisse jamais le spectateur respirer, et joue sur l’impact des images. Une recette qui le suivra jusqu’à Mad Max : Fury Road (notre critique), qui se définit comme un furieux requiem visuel.
Perfect Blue de Satoshi Kon (1997)
Vous reprendrez bien un peu d’anime avec ça ? Il serait en effet dommage d’oublier une partie de la production venue du Japon, d’autant plus que certaines belles œuvres ont atteint les cinémas et vidéoclubs occidentaux depuis les années 80. C’est le cas de Perfect Blue, qui a su montrer que l’animation pouvait très bien jouer sur les ressorts scénaristiques d’un cinéma plus traditionnel.
Réalisé par Satoshi Kon, qui s’occupera ensuite d’autres succès comme Paprika ou Tokyo Godfathers, ce thriller psychologique ne cesse de jouer avec notre perception de la réalité.
Mima est la star d’un groupe de popstar qui monte, mais son agent estime qu’elle doit désormais faire du cinéma. Alors qu’elle quitte ses collègues pour un rôle dans une série TV, elle se sent espionnée par un admirateur de plus en plus inquiétant, qui s’en prend violemment à son entourage professionnel. Obligée de jouer une scène d’agression particulièrement difficile, la jeune femme commence à être victime d’hallucinations. Et si tout se passait dans sa tête ?
Ce premier film permet à Kon d’insuffler une touche particulièrement sombre à un univers souvent perçu comme enfantin. Il deviendra ainsi une vraie inspiration pour d’autres réalisateurs, bien au-delà de l’archipel. Darren Aronofsky fera d’ailleurs de nombreuses références au film dans son propre Black Swan (même constat pour Inception et Paprika), qui est en fait une relecture plus ou moins cachée de l’oeuvre du japonais. En évoquant les thèmes du double et de l’identité au cœur de nos métropoles, Kon livre un film intense, à la croisée des mondes de Hitcock et Disney.
Pusher de Nicolas Winding Refn (1996)
Le cinéma danois est plus connu pour le Dogme95 ou la saga Millenium que pour ses gangsters. Pourtant, Nicolas Winding Refn, devenu célèbre depuis Drive, s’est intéressé aux criminels venus du froid à travers sa trilogie Pusher. On y suit les pérégrinations de Frank et Tony, deux dealers de moyenne envergure qui se retrouvent affublés d’une énorme dette auprès de Milo, un chef de la pègre serbe.
Commence alors une course contre la montre pour trouver son argent. Le film propose une plongée inédite dans le banditisme d’un pays qui n’est pas connu pour cela. Refn y dresse une galerie de drogués instables, qui n’hésitent pas à trahir tout le monde pour arriver à leur fin. Le rythme est soutenu, la mise en scène ultra réaliste.
Au cours de sa carrière, Refn continuera d’épurer son style au maximum jusqu’à volontairement taire les enjeux du récit (The Neon Demon, Only God Forgive…). Pusher est un film plus terre-à-terre, mais pose les premiers jalons de ce style ambitieux. Une œuvre qui mériterait d’être encore plus connue.
Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol (1997)
Andrew Niccol s’est toujours intéressé aux dystopies et la quasi-intégralité de sa carrière tourne autour d’un futur déshumanisé. Bienvenue à Gattaca a beau être son premier long-métrage, il cristallise parfaitement les ambitions de l’américain et reste à ce jour un de ses meilleurs films.
On y découvre un monde futuriste, où il est facilement possible de choisir le génotype de ses enfants pour en faire des êtres humains « parfaits ». Dans cette société eugéniste, les grandes entreprises mettent volontairement de côté les gens normaux, cantonnés à des tâches subalternes.
Gattaca est un centre spatial qui regroupe des chercheurs aux patrimoines génétiques supérieurs. Vincent, enfant conçu naturellement, ne peut que rêver d’y rentrer un jour. Jérôme, candidat idéal ayant vu ses espoirs détruits dans un accident, rêve lui d’une vie plus simple. Les deux hommes vont alors inverser leur identité pour déjouer l’administration paranoïaque de la cité.
L’essence du scénario de Bienvenue à Gattaca se retrouve également dans Truman Show, dont il n’est que le scénariste. On retrouvera également cette idée d’éternel faux-semblant dans la comédie S1mone, avec Al Pacino. Il s’éloignera ensuite de la science-fiction avec le très bon Lord of War, pour y revenir en 2011 avec Time Out. Doté d’un scénario original, ce thriller où le temps remplace toute forme de monnaie reste néanmoins beaucoup trop convenu pour vraiment étonner.
🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités et sur notre WhatsApp. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.