Mais alors qu’est-ce qu’un nanar ? Genre cinématographique à part entière, celui-ci s’avère beaucoup plus complexe à cerner qu’il n’y paraît en raison de sa multitude de variations. On distingue effectivement plusieurs types de nanars : le nanar involontaire/volontaire, fortuné/sans argent, amusant/ennuyeux, etc…Autant de types de films différents que de définitions possibles.
Avant de revenir sur l’origine du mot, revenons un instant sur sa signification dans le langage courant. Le terme de ‘‘nanar’’ désigne aujourd’hui et communément un métrage à la qualité artistique exécrable, mais que l’on peut tout de même prendre plaisir à regarder.
Doit-on alors y voir là une pratique masochiste ? Pas nécessairement, puisque pour un grand nombre de spectateurs, visionner ce genre d’œuvre s’apparente à une expérience proche de celle procurée, par exemple, par une comédie. À ceci près que les mécanismes capables de déclencher du rire ne sont évidemment pas tout à fait les mêmes dans les deux cas.
Plus cynique, moins noble et parfois indissociable de la raison précédente, le fait de railler un mauvais film constitue une seconde explication au visionnement de ce dernier. Dès lors, le mépris se rapproche rapidement de la banale moquerie.
Enfin, à cela s’ajoute une forme de magie inversée. L’enchantement du ‘‘meilleur’’, suscité par des effets spéciaux, un scénario, un casting et une lumière de série A, devient chez le nanar un attrait du ‘‘pire’’. À l’hallucinante performance technique d’un Gravity, se substitue dès lors dans un opus de Sharknado une performance de l’horreur visuelle telle qu’elle en devient tout aussi spectaculaire, à ceci près qu’elle évolue qualitativement parlant dans le sens opposé au travail d’Alfonso Cuaron.
Comment a-t-on pu créer quelque chose d’aussi aberrant, raté, nul ? se demande-t-on à la vision de The Room de Tommy Wisseau. Le visionnement d’un nanar contient en lui ce questionnement, qui défie quelquefois l’entendement humain du bon goût. Et par conséquent, fascine.
Sans véritable équivalent dans la langue anglaise, le terme daterait de son côté du XIXe siècle. À cette époque, il s’orthographiait alors «nanard » ; un mot qui proviendrait du mot d’argot « panard » qui signifie « vieil homme ». On distingue donc le nanar du navet. Dans le premier cas, on parle d’une œuvre certes mauvaise, mais au potentiel comique involontaire. Dans le deuxième, il s’agit seulement de désigner un objet tout aussi raté, mais dénué d’un quelconque aspect de loisir délectable.
Il faut de plus bien départager les différents types de nanar. Car un film ne peut se transformer de la sorte qu’à une seule condition. Si et seulement si son ou ses géniteurs n’avaient pas pour intention de doter leur création d’une nullité extraordinaire au moment de sa fabrication. Ainsi, compliqué d’inclure les nanars conscients de leur bêtise suprême et réalisés dans l’optique de susciter une moquerie précalculée.
Dans cet ordre d’idée, il arrive même qu’un bon film prenne les contours d’un nanar. Kung Fury en est l’exemple parfait. Dans ce cas, on parlera alors davantage de comédie, de pastiche ou de parodie. Vous l’aurez compris, le terrain à explorer est immense. Et il va s’en dire que le dossier qui vous est présenté ici n’ambitionne pas tellement de dresser un panorama complet du nanar que de vous en livrer quelques- uns des représentants les plus insolites et originaux.
[nextpage title=”Nanars et noirs et blancs”]
Reefer Madness (1936)
Si l’on devait citer quelques- uns des tout premiers nanars de l’Histoire du cinéma, Reefer Madness ferait office de référence absolue. Œuvre de propagande anti-marijuana, cette série B d’exploitation met en scène les soi-disant terribles méfaits provoqués par la drogue. On y voit ainsi des personnages basculer dans la folie et commettre des actes de violence immédiatement après avoir consommé du cannabis. Viol, délit de fuite, meurtre…tous les crimes les plus graves y passent.
Dévoué au puritanisme américain des années 30, Reefer Madness se savoure aujourd’hui comme un petit classique du genre. Sorti en France en mars 2006, Reefer Madness : The Movie Musical se présente quant à lui comme un remake profondément ironique de la version originale. Une vraie comédie, peu connue, mais maîtrisée, qui complète parfaitement son aîné.
Plan 9 from Outer Space (1959)
Qualifié de‘‘plus mauvais réalisateur de tous les temps’’ par la presse américaine de l’époque, le réalisateur Ed Wood est une légende du 7e Art. Plan 9 from Outer Space constitue à ce propos l’une de ses créations les plus mythiques, forcément en partie responsables de l’invraisemblable réputation de son auteur.
Parmi les multiples et incroyables ratages qui peuplent la fabrication de cet objet d’anthologie, on peut noter ses innombrables erreurs de raccords, l’histoire de la doublure de Béla Lugosi (celle-là même qui devait placer sa main devant son visage pour ne pas qu’on puisse débusquer l’imposture), et ses effets spéciaux amateurs, mention spéciale aux soucoupes volantes de carton-pâte.
Cependant, derrière ses indéniables et nombreux défauts, Plan 9 from Outer Space est un nanar qui touche à la poésie, tant la sincérité qui l’anime paraît tangible.
Tim Burton rendra d’ailleurs hommage au film et à son incroyable cinéaste dans le fabuleux Ed Wood. Un biopic unique, entre déclaration d’amour à la passion que porte un homme au cinéma et réappropriation intimiste de la vie d’un metteur en scène par un autre. La seule existence de cette pièce maîtresse dans la filmographie du metteur en scène de Beetlejuice nécessite ainsi d’aimer à sa façon Plan 9 from Outer Space et, par extension, ‘‘l’art’’d’Ed Wood.
[nextpage title=”Nanars Couleurs”]
Au temps de la guerre des étoiles (1978)
Non, le pire Star Wars jamais réalisé n’est pas Les Derniers Jedi de Rian Johnson. Plusieurs décennies avant le rejet massif de l’épisode 8 de la saga, le mythe créé par George Lucas bénéficie d’un premier prolongement sous la forme d’un téléfilm bien connu des amateurs d’abominations télévisuelles. Au temps de la guerre des étoiles, tel est le nom de ce méfait commis seulement un an après la sortie du chef-d’œuvre inaugural de 1977.
Au programme donc, un curieux métrage à sketchs où l’on assiste, entre autres, au quotidien de la famille Chewbacca, à un dessin animé maladroitement inspiré de Metal Hurlant, et à des numéros musicaux gênants. À voir pour le croire.
À noter tout de même que ce nanar pur premium marque la première apparition à l’écran du personnage de Boba Fett. Un zeste de génie à l’intérieur d’un véritable sabotage d’une mythologie déjà culte.
Le lac des morts vivants (1980)
« Eurociné était une compagnie étrange. Ils étaient réellement convaincus que des films comme “Le lac des zombies” étaient de très bons films d’horreur ! Ils vivaient sur une autre planète ! C’était tellement étrange que cela devenait merveilleux. » disait Jean Rollin, réalisateur français culte de cinéma bis, à propos de l’illustre boite de production avec laquelle il a mis au monde Le lac des morts vivants, une série Z possédant la particularité de montrer ses acteurs/zombies ne pas réussir à rester en apnée dans une piscine simulant un lac.
Une pièce maîtresse dans l’Histoire de la culture cinématographique hexagonale, injustement oubliée depuis sa sortie. Tout comme son étonnant metteur en scène.
Turkish Star Wars (1982)
De Star Wars, Turkish Star Wars n’en possède pas seulement le nom. Il en utilise également plusieurs extraits, dont les célèbres séquences d’action dans l’espace. Celles-ci se retrouvent ici ignoblement incrustées dans le dos de deux pilotes pour donner l’illusion d’être dans un space opera. Passé ce prologue de haut niveau, l’histoire dirige les héros sur une planète inconnue où se poursuit, pour eux, et pour nous spectateurs, une aventure de plus en plus dantesque dans le vertige de la nullité.
On citera, parmi les plus fabuleuses extravagances de ce Turkish Star Wars, l’emploi de stocks shots de pyramides censées passer pour une civilisation très ancienne, la présence de la musique d’Indiana Jones, une esthétique indescriptible (certaines créatures ne ressemblent tout simplement à rien), et des combats grotesques où les personnages effectuent des sauts à l’aide de trampolines.
Taux de nanardise ? Maximal.
Superman IV (1987)
Super nanar produit par la Cannon dans les 80’s, cette quatrième aventure de Superman vaut le détour pour tout amateur de grand projet malade qui se respecte.
Incroyable, mais pourtant bien vrai, le film voit son budget coupé de moitié lors de sa pré-production. Il devient par conséquent l’opus le plus pauvre de la franchise jamais réalisé jusque là. Les 36 millions initialement prévus passent à 17. Le résultat à l’écran, et notamment les effets spéciaux, sont catastrophique.
Un affrontement de titans :
https://www.youtube.com/watch?v=NrAp1GkIvgY
Le ridicule atteint un tel point de non-retour lorsque Superman effectue un simple vol dans les airs ou qu’il combat un ennemi dans l’espace que l’on pense assister par instant à une parodie des précédents épisodes. L’homme d’acier écope même cette fois-ci de pouvoirs inédits, comme celui de pouvoir reconstruire un monument détruit (ici la Grande Muraille de Chine) à l’aide de ses yeux lasers. Une innovation que les volets suivants préféreront oublier.
Crocodile Fury (1988)
Dans un petit village en Thaïlande, les habitants se font dévorer les uns après les autres par un féroce crocodile. Jack, l’un des villageois, décide de parler à l’animal et découvre bientôt que la bête est la réincarnation de sa fiancée Maria. Tel est le postulat de départ de Crocodile Fury, un irrésistible ‘‘2 en 1’’, c’est-à-dire un mélange de deux films différents qui aboutissent, via le montage, à un seul. Généralement composé d’un métrage asiatique volé et complété par des séquences tournées avec des acteurs occidentaux quelques années plus tard, ce type de nanar donne bien souvent naissance à des absurdités totales.
Dans le cas présent, l’aberration relève de la performance artistique tant le film parvient à enchaîner à peu près tous les codes d’une production cinématographique désastreuse (erreurs techniques, monstre en plastique, intrigue au-delà de l’incohérence, escroquerie du procédé de départ…). Dès lors, Crocodile Fury semble pris quelque part dans les limbes de l’impossibilité, tel un best of du pire qui aurait convoqué l’esprit des plus fantasque et odieux fabricant de séries Z.
Le Clandestin (1988)
Sorti directement en vidéo (encore heureux) à la fin des années 1980, Le Clandestin narre une histoire pour le moins classique : réuni sur le yacht d’un milliardaire véreux, un groupe de gens se retrouve confronté à un chat mutant qui se met à les décimer un par un. De ce pitch assez banal, qui évoque pléthore de films de monstres faits avant lui, le métrage se démarque grâce à son animal tueur. Ce dernier engendre en effet la principale source de désastre rétinien au sein de l’œuvre.
Jamais crédible, il n’évoque jamais rien d’autre qu’une peluche hystérique. Parmi les moments mémorables du Clandestin, on retiendra conséquemment la magistrale transformation du félin en mutant assoiffé de sang. Une scène qui donne à voir un chat accoucher par la bouche d’une difforme et plus petite version de lui-même. Subjuguant de disgrâce. Ou quand l’horreur devient horrible.
Ils sont absents, mais on aurait pu en parler :
- L’Homme puma d’Alberto De Mortino
- Virus Cannibale de Bruno Mattei
- Les Rats de Manhattan de Bruno Mattei
- Clash Commando de Godfrey Ho
- Devil Story : Il était une fois le diable de Bernard Launois
- Invasion U.S.A de Joseph Zito
- Dark Missions, les fleurs du mal de Jesus Franco
- Et bien d’autres…
[nextpage title=”Nanar 2.0 “]
The Room (2003)
Classique parmi les classiques, The Room est devenu pour beaucoup et en l’espace d’un peu moins de deux décennies, le ‘‘pire film de tous les temps’’. Devançant donc désormais le Plan 9 from Outer Space de Ed Wood et le Turkish Star Wars de Cetin Inanç dans cette catégorie, la création de Tommy Wiseau s’appréhende comme un scandaleux tour de force. Pétrie d’une prétention et d’intentions disproportionnées vis-à-vis du réel talent de son géniteur, cette bande désormais cultissime accumule presque miraculeusement tout ce qu’il ne faut pas faire dans un film.
Imaginée à l’origine comme un grand drame romantique et universel, l’histoire de The Room reste difficile à résumer. Il y est essentiellement question de trois personnages formant un triangle amoureux : Johnny (Wiseau lui-même), Lisa, sa fiancée, et Mark, amant de ce celle-ci et, oh drame, meilleur ami de Johnny. Du reste, le scénario aime à multiplier les scènes n’allant nulle part et les dialogues absurdes. En témoigne cet extrait : Mark : ‘‘Comment s’est passé ton boulot aujourd’hui ?
Johnny : Oh, plutôt bien. Nous avons eu un nouveau client et la banque va faire beaucoup d’argent.
Mark : Quel client ?
Johnny : Je ne peux pas te le dire ; C’est confidentiel.
Mark : Aw, allez. Pourquoi pas ?
Johnny : Non, je ne peux pas. Bref, comment se passe ta vie sexuelle en ce moment ?’’
De ce capharnaüm où manque de savoir-faire, mégalomanie et sincérité se bousculent, on préférera retenir l’histoire derrière le film. The Disaster Artist, biopic centré sur Tommy Wiseau et la réalisation de The Room, en dressera lors de sa sortie au cinéma un panorama saisissant. Une occasion de découvrir la personnalité hors norme du metteur en scène, un loser magnifique engoncé entre l’autisme touchant et l’arrivisme toxique. Un homme à l’image de son travail, en somme.
House of the dead (2003)
Qui dit nanar, dit forcément Uwe Boll. Réalisateur, scénariste et producteur allemand souvent détesté (à raison) par les cinéphiles, celui-ci se sera évertué durant sa carrière à saccager quelques-unes des licences de jeux vidéo les plus fameuses. Alone in the Dark, BloodRayne 1 et 2, Far Cry, et Postal figurent ainsi dans son riche et calamiteux palmarès. Palmarès que vient allégrement rejoindre House of the dead, adaptation de la série vidéoludique éponyme de Sega.
Si les jeux originaux, des rail shooter d’abord jouable sur borne d’arcade avant d’être portés sur PC, brillaient par leur efficacité redoutable et leurs effusions spectaculaires de gore, il en va tout autrement pour leur version cinéma. Avec ses personnages de jeunes décérébrés, ses effets de ralentis déjà ringards au moment de sa sortie, et sa nudité gratuite, House of the dead s’est très vite imposé comme l’un des monuments de la nanardise moderne.
À propos de sa création, Boll, jamais avare en humilité, a déclaré ceci :‘‘J’étais énervé à cause de certains journalistes qui n’ont aucune idée de la complexité de ce qu’est, par exemple, de réaliser un plan façon Matrix avec 300 caméras. Ils ont tenté de me blâmer pour ma parfaite maîtrise de techniques complexes.’’ Une déclaration qui met en exergue le décalage dans le réel de cet étonnant être humain qu’est le papa de Rampage.
I am here…now (2009)
Dans les étendues désertiques du Nevada, The Being (Neil Breen, acteur, producteur et réalisateur du film) fait son apparition. ‘‘ Les criminels de Wall Street. Les politiciens cupides. Les avocats et compagnies d’assurances qui mentent… tous détruisent ce que j’ai prévu pour cette planète. Je les éliminerai si les humains ne s’en chargent pas’’ prononce le mystérieux protagoniste un peu plus tard en voix off pour dévoiler ses intentions au spectateur. Sorte de Dieu venu sur terre, le personnage, lunaire au possible, ressemble à un mélange de Keanu Reeves et de Patrick Swayze du pauvre. Une remarque qui suffit à elle seule de justification à l’existence de ce nanar polyvalent.
À la fois trip métaphysique, expérimental, politique, religieux et messianique au-delà de toute loi artistique, I am here…now réussit l’exploit de mêler des genres tous plus ambitieux les uns que les autres, sans ne jamais prendre une once de recul. Que dire également de sa musique, strictement imbitable, ou encore de sa tonalité si prétentieuse et, par conséquent, si bizarre, qu’elle déstabiliserait même le plus averti des cinéphages ?
Vous l’aurez compris, cette production Neil Breen se distingue du peloton de la médiocrité habituelle de par l’incommensurable insanité de son auteur. Une référence de la bêtise stratosphérique.
The Amazing Bulk (2010)
De son simple titre à ses passages les plus anodins en passant par les interviews de son cinéaste, The Amazing Bulk déstabilise.
« Honnêtement mes plus grandes inspirations quand j’ai fait ce film, ce sont les séquences animées qu’on voit dans Mary Poppins, Qui veut la peau de Roger Rabbit et Speed Racer. Mais je me rends compte que les gens ont du mal à accepter l’idée de personnages réels dans un univers animé. » déclare Lewis Schoenbrun, le réalisateur de The Amazing Bulk, lorsqu’on le questionne sur son travail. Des propos pour le moins étranges, qui brouillent les frontières entre premier degré et humour décalé.
https://www.youtube.com/watch?v=zT-qB3XmzH8
Difficile effectivement de savoir si le métrage a été conçu comme un nanar volontaire ou involontaire. Tout juste soulignera-t-on l’existence de ces séquences contenant de l’animation et autres effets spéciaux numériques délirants. L’une d’entre elles montrant par exemple une femme les yeux bandés palper les parties intimes de Bulk, une créature violette inspirée du super héros vert de Marvel. Le tout avec un rendu visuel général digne d’un jeu sur navigateur datant de la décennie précédente. Fou.
https://www.youtube.com/watch?v=ywaR-Lq_ayk
Ils sont absents (et c’est tant mieux), mais on aurait aussi pu en parler :
- The Da Vinci Treasure de Peter Mervis
- I am Omega de Griff Furst
- Transmorphers de Leigh Scott
- Mega Shark vs Mecha Shark de Emile Edwin Smith
- Alone in the Dark d’Uwe Boll
- Birdemic de James Nguyen
- Snowboarder d’Olias Barco
- Et bien d’autres…
[nextpage title=”Gros moyens pour gros nanar”]
Batman et Robin (1997)
Après deux excellents opus signés Tim Burton (Batman et Batman le défi), la licence axée sur le justicier de Gotham se poursuit dans les années 1990 avec le diptyque de Joel Schumacher, Batman Forever, puis Batman et Robin. Si le premier relève déjà du kitsch halluciné, le second s’engouffre dans une voie encore plus délicate. Les jeux de mots incessants de Mr Freeze :‘‘Bulletin météo du jour : je vais jeter un froid’’, les gros plans sur les fessiers des héros, les costumes carnavalesques de Bane et Poison Ivy, l’esthétique générale très gay,…Tout prête à la consternation, et au rire.
Une fois l’orientation prise par le film assimilée, il est en effet difficile de ne pas en apprécier la plupart des idées et l’humour flirtant avec la parodie. Grosse production oblige, certaines séquences démontrent même une ampleur intéressante. La course poursuite sur le bras d’une gigantesque statue impressionne de fait toujours. Et l’ensemble, ancré dans un imaginaire finalement très personnel (Schumacher est ouvertement homosexuel), procure à ce Batman et Robin une réelle singularité.
Plaisir coupable ? Assurément.
Torque, la route s’enflamme (2004)
En guise de tagline, l’affiche de Torque indique : « Par le producteur de Fast and Furious, S.W.A.T et xXx ». Un bon résumé de la note d’intention de cette production décérébrée à gros budget, à ceci près que celle-ci a été réalisée par Joseph Kahn (le très ambitieux fan film Power/Rangers). L’homme, dont le nom reste peu connu du grand public, possède indéniablement un certain talent en même temps qu’une grande passion pour le cinéma. Malheureusement, sans doute par excès de bonnes intentions, il crée avec Torque une sorte de ratage monumental, à mi-chemin entre le pur produit d’entertainment beauf et le délire d’action inclassable.
https://www.youtube.com/watch?v=2o0_YJlN89s
À l’image de cette course poursuite sur un train réalisée avec des cascades réelles et des CGI, la mise en scène privilégie une pseudo originalité faite d’accélérations démentielles et surréalistes des véhicules au détriment de toute cohérence. Il faut alors s’imaginer assister par moment à une sorte de cartoon live possédé par le style visuel d’un Michael Bay en bad trip. Un style visuel (trop) avant-gardiste dans un sens, que l’on retrouve pour l’anecdote dans le célèbre clip de Toxic, l’un des titres les plus populaires de Britney Spears enregistré au début des années 2000.
Tourné par Kahn l’année précédant la sortie de son blockbuster motorisé, ce court film musical met notamment en scène un Martin Henderson (le héros biker de Torque) empoisonné par la popstar blonde dans les dernières secondes de la vidéo. S’ajoutent à cela de nombreux effets spéciaux numériques, dont une ballade à moto tape à l’œil qui voit la chanteuse bondir dans les airs pour ensuite parfaitement se réceptionner au sol. Que l’on adhère ou pas, c’est tout simplement magique.
https://www.youtube.com/watch?v=BNFCXxqKGiY
Pour plus de nanars à (re)découvrir :
🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités et sur notre WhatsApp. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.


















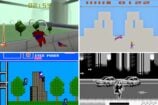





J’aurais facilement rajouter Fast And Furious 7 et 8 tellement y’a des scènes qui m’ont donné envie de vomir dans la salle de cinéma.
Bel article, même si effectivement je pense qu’il serait impossible de répertorier toutes les œuvres nanars jamais inventées…
Mention spéciale pour moi a toute l’œuvre de Andy SIDARIS (piège mortel à Hawaï)
Merci pour l’article en tout cas et en espérant que d’autres sur ce thème puisse voir le jour. 🙂