Difficile de trouver une origine à un cinéma jugé de ‘‘complexe’’, tant une partie de cette appréciation dépend de la subjectivité de chacun et de l’époque. Par exemple, un métrage muet ne jouit aujourd’hui pas nécessairement de la même compréhension que lors de sa sortie, en raison de l’évolution de l’œil du spectateur et de la manière de raconter une histoire avec une caméra. Par ailleurs, il n’existe tout simplement pas d’appellation académique qui qualifierait, en tant que genre, un film dit de ‘‘compliqué’’.
Certaines catégories demeurent toutefois plus propices à proposer des récits confus et/ou des images déroutantes : le thriller (Le Faucon Maltais, 1941), le drame psychologique (Persona, 1966), le fantastique (Shining, 1980), la science-fiction (2001 : L’odyssée de l’espace, 1968), et l’expérimental (The Ghost Train, aux alentours de 1901-1903, et Meshes of the Afternoon, 1943) en font indéniablement partie.
https://www.youtube.com/watch?v=ihQurg4xGcI
Mais plus peut-être que le genre, l’existence et le style de cinéastes réputés pour leur filmographie difficile d’accès s’avèrent fondamentaux dans la recherche d’un cinéma complexe. On notera ainsi, et entre autres, les noms célèbres d’Ingmar Bergman pour son travail philosophique, onirique et métaphysique sur Le septième Sceau et L’heure du loup, Alejandro Jodorowsky et David Lynch pour leur amour vis-à-vis du surréalisme avec, respectivement, La Montagne Sacrée et Erasherhead, Andrei Tarkovsky avec Stalker et Le Miroir et le théorique Jean-Luc Godard avec Adieu au langage.

Ce mois-ci, le journal du geek vous transmet donc certains des films les plus compliqués à appréhender pour l’esprit humain. Précisons néanmoins que ces derniers, bien que très majoritairement reconnus comme étant de nature alambiquée, ne jouissent pas tous du même degré de complexité/compréhension, et qu’ils ne répondent pas forcément aux mêmes mécanismes de confusion. Là où quelques-uns d’entre eux s’appuieront sur une imagerie de cinéma surréaliste, d’autres joueront davantage sur un art manipulateur de narration. Alors que d’autres s’amuseront à mêler les deux. Bref, c’est complexe.
Sachez pour finir que toutes les explications contenues dans ce dossier ne se suffisent pas obligatoirement à elles-mêmes, et n’annulent en rien toutes les autres interprétations possibles et imaginables proposées par le passé ou encore aujourd’hui par chaque spectateur, cinéphile, spécialiste amateur et/ou professionnel du 7e Art. Attention, spoiler alert, donc. Et nous vous conseillons vivement d’avoir vu les films avant de lire les explications.
[nextpage title=”Un film de légende”]
Un chien andalou (1929)
L’histoire : Pas facile de résumer le scénario d’Un chien andalou, tant ce dernier ne répond pas aux règles habituelles de dramaturgie. Tout juste mentionnera-t-on une succession de scènes, en apparence dépourvues de logiques les unes des autres malgré des motifs récurrents. Tout débute sur un balcon où un homme tranche l’œil d’une femme à l’aide d’un rasoir, alors qu’un nuage passe devant la lune. S’ensuit une ellipse où un carton affiche à l’écran : ‘‘Huit ans après’’. Puis un cycliste tombe dans la rue, une femme vient vers celui-ci et l’embrasse, etc.
L’explication : Porte-étendard du cinéma surréaliste réalisé par Luis Buñuel (L’Ange exterminateur), Un chien andalou se doit d’être éprouvé avant d’être compris, et, chose rare, ne bénéficie pas forcément d’explication. En effet, c’est son propre metteur en scène qui l’affirmait dans son autobiographie : ‘‘Le scénario fut écrit en moins d’une semaine selon une règle très simple adoptée d’un commun accord : n’accepter aucune idée, aucune image qui pût donner lieu à une explication rationnelle, psychologique ou culturelle. Ouvrir les portes à l’irrationnel. N’accueillir que les images qui nous frappaient, sans chercher à savoir pourquoi’’.
L’explication n°2 : Pour certains analystes, le mémorable plan de l’œil coupé au rasoir au début du film symbolise la note d’intention du projet : il faut détruire le regard pour en découvrir un nouveau, plus libre, et à même de nous faire accepter des images n’ayant plus entre elles de liens logiques. Il s’agit en quelque sorte d’une révolution, d’un appel à voir le monde différemment, où les conventions cinématographiques — narratives, morales, formelles — se retrouvent renversées.
L’explication n°3 : Buñuel et Dali signèrent cette note évocatrice dans la revue Mirador : “Un chien andalou a eu un succès sans précédent à Paris ; ce qui nous soulève d’indignation comme n’importe quel autre succès public. Mais nous pensons que le public qui a applaudi Un chien andalou est un public abruti par les revues et “divulgations” d’avant-garde, qui applaudit par snobisme tout ce qui semble nouveau et bizarre. Ce public n’a pas compris le fond moral du film, qui est dirigé directement contre lui avec une violence et une cruauté totales.” Ces propos mettent en exergue la volonté des deux hommes de choquer et provoquer une partie du public, et en particulier celui appartenant à l’élite culturelle parisienne. Dans ce conteste, Un chien andalou doit être perçu comme une œuvre révoltée, aussi adolescente dans l’âme que percluse d’une force artistique incandescente et insaisissable.
[nextpage title=”Lynch, Cronenberg et Jonze : trois auteurs, trois œuvres cultes”]
Mulholland Drive (2001)
L’histoire : Suite à un accident de voiture sur la route de Mulholland Drive à Hollywood, une jeune femme prénommée Rita devient amnésique. Bientôt aidée par Betty Elms (Naomie Watts), une actrice tentant de percer dans le milieu du cinéma qu’elle vient de rencontrer, Rita décide de partir à la recherche de son identité et de retrouver, par la même occasion, sa mémoire.
https://www.youtube.com/watch?v=dl9jSfdyspg
L’explication : Dans un café, un homme raconte à un autre l’un de ses cauchemars avant que celui-ci ne devienne réel. Sur un plateau de tournage, Betty croise le regard d’Adam, un réalisateur en vogue à Los Angeles, et paraît prise d’un malaise soudain et inexplicable. À un autre moment encore, une chanteuse dans un théâtre s’évanouit pendant que sa voix continue d’être entendue. Du ‘‘pur’’ David Lynch en somme, comme beaucoup le diraient pour désigner simplement une succession d’idées surréalistes, déroutantes et au premier abord indéchiffrables.
Seulement chez le co-créateur de Twin Peaks, tout a un sens. Et Mulholland Drive ne déroge pas à ce principe. Les 110 premières minutes sont un rêve, celui de Diane/Naomie Watts (Betty et Rita dans le rêve), et la dernière demi-heure illustre le réveil et la douloureuse réalité de ce personnage. Une fois cette donnée acquise, tout s’éclaire. Il y a donc deux histoires en une. La première narre un songe illustrant l’inconscient de Diane. Celui-là même qui déclenche la seconde histoire et la prise de conscience de la jeune femme dans la vie réelle. On comprend conséquemment que Diane souffre d’une rupture amoureuse. Suite à cet événement, elle décide de faire tuer son ex-petite amie avant de finir par se donner la mort. Dans ce dénouement glauque et désespéré, fait de haine et de remords, le rêve a joué un rôle psychanalytique. Et la réalité, celui d’un monde cauchemardesque où plane l’ombre d’un Los Angeles malsain et sans pitié.
Le Festin Nu (1991)
L’histoire : Au début des années 50, William Lee, un écrivain en devenir gagnant sa vie en exterminant des cafards, tue accidentellement sa femme après une prise de drogues. Suite à ce tragique événement, l’homme prend la fuite dans l’Interzone. Arrivé sur place, il se met à travailler en tant qu’espion pour un vaste et étrange réseau. Il reçoit alors sa première mission : il doit séduire Joan Frost, une intellectuelle qui s’avère être le double parfait de son épouse décédée. Dans la quête de cet objectif, William se confronte à un monde peu ordinaire, où prennent notamment vie des machines à écrire insectes.
L’explication : Adaptation au cinéma par David Cronenerg (La Mouche, A History of Violence) du livre réputé inadaptable de William Burroughs, Le Festin nu jouit d’une multitude de sous-textes. L’un d’entre eux est une réflexion sur les affres de la création artistique. Souvent perçue comme un métier de rêve par ceux et celles qui n’en ont jamais fait l’expérience, le travail d’un écrivain, tout comme celui de n’importe quel artiste (scénariste, metteur en scène, photographe, etc.) se définit de manière obligatoirement plus complexe. Chez Cronenberg, le talent littéraire de William Lee prend ainsi le contrôle sur ce dernier. L’imaginaire, et la faculté à le faire surgir d’un esprit inspiré, se vivent dès lors comme une malédiction, un fardeau. Une idée qui se matérialise dans le film sous la forme de l’Interzone, un lieu métaphorique de l’espace cérébral du personnage principal.
Le Festin nu prend dès lors un chemin anxiogène, constitué de violence et de destruction. Deux éléments indissociables du pouvoir créateur de l’écrivain. Car c’est bien en tuant sa femme que William s’affirmera comme un grand auteur, la souffrance de la perte de l’être cher le transcendant pleinement. Dans cette optique, cette adaptation du roman de Burroughs se rapproche fortement du Mother ! de Darren Aronofsky. Dans les deux cas, le génie se distingue en effet par un goût prononcé pour les névroses. Les mêmes capables de se retrouver endigués par la production finale de l’objet artistique qu’elles ont aidé à mettre au monde.
https://www.youtube.com/watch?v=zfuzjXhJ-CQ
Dans la peau de John Malkovich (1999)
 L’histoire : Un marionnettiste de rue, Craig Schwartz, se trouve pris dans des difficultés financières. Comme si cela ne suffisait pas, sa femme semble s’intéresser davantage à ses animaux qu’à lui. Face à ces problèmes, l’homme tente de prendre en main ses responsabilités et finit par trouver un emploi au septième étage de l’entreprise Lester. Rapidement, alors qu’il classe des dossiers, Craig fait une découverte extraordinaire : derrière une porte dérobée dans son bureau se trouve un portail qui mène directement au psychisme de l’acteur John Malkovich.
L’histoire : Un marionnettiste de rue, Craig Schwartz, se trouve pris dans des difficultés financières. Comme si cela ne suffisait pas, sa femme semble s’intéresser davantage à ses animaux qu’à lui. Face à ces problèmes, l’homme tente de prendre en main ses responsabilités et finit par trouver un emploi au septième étage de l’entreprise Lester. Rapidement, alors qu’il classe des dossiers, Craig fait une découverte extraordinaire : derrière une porte dérobée dans son bureau se trouve un portail qui mène directement au psychisme de l’acteur John Malkovich.
L’explication n°1 : Dans la peau de John Malkovich n’est pas, à proprement parler, difficile à comprendre. Du moins pas dans la façon de suivre son histoire, aussi bizarre soit-elle. La déstabilisation suscitée par le film provient plutôt du surréalisme de son concept, à même de braquer les spectateurs les plus terre à terre, et des diverses interprétations que l’on peut en faire. Il est effectivement facile, face à la séquence du restaurant où tous les personnages présents revêtent le physique de l’acteur en ne s’exprimant qu’avec le nom de ce dernier (‘‘Malkovich Malkovich’’), de rejeter en bloc la proposition de cinéma faite par Charlie Kaufman (Anomalisa) et Spike Jonze (Max et les Maximonstres, Her). Cependant, pour peu que l’on soit réceptif à la tonalité proposée, il convient d’observer Dans la peau de John Malkovich sous un angle analytique pour en tirer son plein potentiel.
De fait, son explication principale réside dans le traitement de la thématique de l’identité. Craig Schwartz est un homme en souffrance, qui ne parvient pas à réussir dans sa vie professionnelle et dont le mariage s’étiole. Le fait de découvrir le portail le faisant accéder au psychisme du comédien américain va par conséquent lui servir de substitut à ses conflits personnels et lui permettre de vivre un temps l’existence de Malkovich. Tel un échappatoire, le procédé lui permet de questionner son identité et, à la fin, de la trouver ou non. Pour faire simple, c’est au voyage initiatique de Schwartz dans la tête d’un autre auquel on assiste.
L’explication n° 2 : Pour aller plus loin, examinons le procédé qui permet à Craig de se rendre dans l’autre monde (le psychisme de Malkovich). Pour ce faire, il pénètre un long couloir débouchant sur une deuxième réalité qui, au bout d’une dizaine de minutes, le rejette dans son univers d’origine, jusqu’à ce que le personnage réitère le processus. Il y a là un protocole cyclique, qui fait implicitement référence à la condition humaine, mais aussi au processus de création. Le fait que Craig puisse prendre le corps de Malkovich tout en conservant son esprit aboutit ainsi à une nouvelle forme d’être. Pour le marionnettiste, devenu une sorte de Dieu, le bonheur ne semble alors accessible qu’en refusant son identité première au profit d’une nouvelle partagée entre lui-même et le populaire acteur.
[nextpage title=”Science fiction et réflexions”]
Au-delà du réel (1980)
L’histoire : Edward Jessup est un chercheur à l’Université de Cornell. Dans le but d’étudier et de comprendre les origines de l’apparition de la vie, il décide de s’enfermer dans un caisson d’isolation sensorielle et d’absorber des hallucinogènes. Débute alors pour lui une aventure mentale et une quête d’identité où visions et fantasmes liés à son enfance se mêlent à de vastes interrogations et découvertes sur l’univers.
L’explication : Nanar 70’s pour certains, chef d’œuvre pour d’autres, au-delà du réel divise encore 38 ans après sa sortie. Il faut dire que le film de Ken Russel ne se laisse pas si facilement aborder, tant il s’évertue à fabriquer des images où le sublime côtoie la série B underground. Un peu comme dans un 2001 : l’odyssée de l’espace qui se déroulerait dans la tête d’un homme sous LSD en quelque sorte, avec des effets spéciaux tantôt grotesques, tantôt réussis. Évidemment, présenté de la sorte, cela paraît déjà spécial et désorientant. Un sentiment normal compte tenu des thématiques psychédéliques et métaphysiques abordées dans cet ovni underground.
Après tout, l’enjeu d’Edward Jessup est de découvrir l’origine de la vie. Une quête qui le mène à apprendre que toute chose descend du néant, entité absurde par excellence que seul l’amour arrive à transcender lors du climax. Christopher Nolan saura s’en souvenir des années plus tard pour Interstellar et sa relation père/fille capable d’outrepasser les contraintes imposées par le temps et l’espace. Ensorcelant.
Une reprise humoristique par South Park du climax d’Au delà du réel
Matrix Reloaded (2003)
L’histoire : Après avoir vaincu l’agent Smith dans le premier volet, Neo embrasse de plus en plus sa destinée d’élu et apprend à mieux contrôler ses pouvoirs. De son côté, Sion, la cité des résistants humains, est grandement menacée par l’Armée des Machines. Cette dernière compte lancer un assaut de pieuvres robotiques sur la communauté dans le but de l’anéantir. Pour Morpheus, le dernier espoir pour les citoyens de son espèce réside dans l’accomplissement de la prophétie, à savoir la victoire de Neo contre les Sentinelles.
L’explication : Si le premier opus de la saga de science-fiction des Wachowski proposait déjà un discours philosophique et une complexité inhabituelle pour un blockbuster hollywoodien, son successeur va infiniment plus loin. ‘‘Tu as déjà fait ce choix, maintenant tu vas devoir le comprendre’’ déclare l’Oracle à Neo. ‘‘Le pourquoi est la seule source de pouvoir, sans elle tu es impuissant’’ lui dit plus tard le Mérovingien. Dans Matrix Reloaded, tout est affaire de choix et de la raison pour laquelle celui-ci est effectué.
https://www.youtube.com/watch?v=aGgBjAR3lys
Une parodie de la séquence de l’Architecte par les MTV Movies Awards 2003
À mi-parcours, lors de la séquence de l’Architecte où Neo rencontre le ‘‘Dieu’’ de la matrice, un long discours cryptique nous livre quelques-unes des clefs de la trilogie. Dans ce dialogue, on y apprend que le héros interprété par Keannu Reeves est le sixième élu, et que son statut de prophète que l’on croyait jusqu’à présent unique ne l’est absolument pas. En réalité, l’information capitale réside dans le fait que l’élu est un programme créé dans le but de ‘‘rebooter’’ la matrice, et que la rébellion est par conséquent un leurre.
Là où les choses se compliquent, c’est dans le choix qu’effectue Neo. Alors que les machines s’apprêtent à venir détruire Zion, l’architecte lui propose deux solutions : soit il réactive de lui-même la matrice et sélectionne 23 humains pour reconstruire la cité de la résistance, soit il refuse pour sauver Trinity et laisse l’humanité tout entière périr pour de bon. Contrairement aux cinq précédents élus, Neo choisit la seconde option. Et permets alors de totalement court-circuiter le cycle instauré jusqu’à présent par les machines. Son choix, effectué par amour et espoir, provoque de fait une anomalie dans le système qui permettra dans le volet suivant d’effectuer la révolution tant attendue.
Un extrait du dialogue mindfuck entre Neo et l’Architecte : —L’architecte : ‘‘Si je suis le père de la matrice elle en est indubitablement la mère.
—Neo : L’oracle.
—L’architecte :Voyons… Donc elle a trouvé une solution avec laquelle 99% des sujets testés acceptaient le programme s’ils avaient le choix, même si ce choix se faisait à un niveau inconscient. Ceci fonctionnait mais était de toute évidence fondamentalement imparfait et créait l’anomalie systémique contradictoire qui, incontrôlée, mettait en danger le système lui-même. Donc, la minorité incontrôlée qui refusait le programme augmenterait la probabilité d’un désastre.’’
Southland Tales (2007)
L’histoire : En 2008, l’Amérique a basculé dans la troisième guerre mondiale suite à une attaque nucléaire. Le pays subit alors une pénurie de carburant très importante. Pour mettre fin au problème, une grande société fait construire un générateur d’énergie capable de canaliser les flux de l’océan. Mais cette technologie altère le mouvement de rotation de la terre, ce qui provoque une brèche dans l’espace temps et, par conséquent, déséquilibre les comportements humains. Dans ce contexte, les vies de Krista Now, une ancienne star du porno, et Boxer Santaros, un acteur amnésique, vont se retrouver totalement bouleversées. À l’aide de deux frères jumeaux et d’un sénateur, les deux protagonistes sont ainsi rapidement embarqués dans une lutte dont l’enjeu pourrait bien être le destin de l’humanité.
L’explication : Richard Kelly n’est pas un réalisateur comme les autres. Son premier film, le culte Donnie Darko, montrait déjà des signes évidents de sa différence. Sans doute trop, pour la majeure partie du public. Un triste constat qui aura d’ailleurs valu à Southland Tales d’échouer commercialement au box-office et de disparaître rapidement des mémoires. Pourtant, de cette étrange œuvre apte à recevoir aujourd’hui une réévaluation, il faut y voir une véritable proposition artistique, certes déroutante et imparfaite, mais absolument fascinante.
‘‘À mon avis, seul le réalisateur a compris son film.’’ Ce commentaire d’un internaute à propos de Southand Tales résume plutôt bien l’incompréhension que le film a suscitée en son temps.
https://www.youtube.com/watch?v=SfxKichbdTE
Pour en cerner la signification, mieux vaut posséder le bagage culturel et référentiel nécessaire, ainsi qu’une certaine ouverture d’esprit. Un fin connaisseur de la pop culture s’y retrouvera ainsi mieux qu’un spectateur lambda en décelant des influences diverses et variées à Philip K. Dick, David Lynch, T.S Eliot et Terry Gilliam. Du reste, le métrage s’apparente à une sorte de portrait absurde de l’Amérique post-11 septembre et du monde en général. Le tout avec un mélange des genres ahurissants : comédie musicale, thriller, science fiction, romance, drame, comédie… L’alliance de l’ensemble est si foisonnante qu’elle permet à Southland Tales de ne ressembler à pratiquement rien de connu.
https://www.youtube.com/watch?v=_3Y3VBjLGmU&index=5&list=PL1B8055431565FDE0
“Je crois que le message c’est qu’il faut affronter ses propres démons intérieurs. Je crois que tout être humain lutte, tous les jours, en se regardant dans la glace, contre lui-même, contre ses propres dysfonctionnements. Et les dysfonctionnements d’un être peuvent s’appliquer à une communauté, et peut-être même à toute une nation. Je ne veux pas avoir l’air d’être « New-Age », ou d’un gourou de l’estime de soi, mais tout part de l’individu, de soi-même. Je pense que si l’on essaie de tout ramener à un seul concept, c’est celui-ci. C’est pourquoi le film se conclut simplement sur l’idée du pardon. (…) Et sur l’amitié.’’ disait Richard Kelly de son propre film. De ce dernier, c’est probablement cela qu’il faut retenir : une incroyable simplicité du propos derrière une histoire rocambolesque qui ne répond pas à la normativité habituelle des productions cinématographiques US.
Inception (2010)
L’histoire : Dom Cobb, un voleur spécialisé dans l’extraction de secrets enfouis dans le subconscient d’individus, reçoit un jour une mission périlleuse. À l’aide d’une équipe, il doit réaliser une inception, une pratique consistant à d’implanter une idée dans l’esprit d’une personne. Parallèlement à cela, le sombre passé de Cobb, hanté par le suicide de sa femme, et la venue d’un terrible adversaire vont venir compliquer l’aventure.
L’explication : La toupie tombe-t-elle à la fin ? Cobb est-il toujours dans le monde des rêves ou vient-il réellement de retrouver ses enfants ? Voici ce qu’en pense Christopher Nolan, le réalisateur d’Inception : ‘‘À la fin de ce film, le personnage de Leonardo DiCaprio, Cobb, se retrouve avec ses enfants, au moins dans sa réalité subjective. Il n’en a plus rien à faire et cela dit quelque chose : peut-être que tous les niveaux de réalité sont valables. La caméra s’approche de la toupie qui tourne, et au moment où elle se met à vaciller, l’image laisse place à un écran noir. La réaction du public à cela est très forte… La question de savoir si c’est un rêve ou pas est celle qu’on me pose le plus. Ça compte pour les gens parce que c’est l’essence même de la réalité. La réalité compte.’’
Ces paroles du cinéaste valident une première théorie. Théorie selon laquelle savoir si Cobb se trouve dans notre réalité ou non lors des cinq dernières minutes n’a finalement que peu d’importance. Ce qui importe, ce n’est ainsi pas la réponse, mais le questionnement. Il s’agit d’ailleurs du principe de la fin ouverte. Grâce au doute instauré par sa résolution, le récit se pare d’une ambiguïté capable de laisser davantage de liberté au spectateur, et donc d’amener ce dernier à penser. Une manière également de dire que, comme dans le monde réel, accéder à la vérité n’est jamais chose simple. Et que se mentir à soi-même comme le fait si bien le héros de Memento demeure parfois la seule solution envisageable à la dureté du réel.
L’explication n°2 : Bousculons légèrement ces acquis. Et si la fin d’Inception ne prêtait absolument pas à débattre ? Effectivement, si l’on regarde de près et jusqu’à la dernière image, la toupie vacille et manque de tomber dans les toutes dernières secondes. Cette instabilité de l’objet l’ancre alors logiquement dans la réalité. À cet instant, Cob est donc sorti du monde onirique et a droit à son happy end. Dans cette hypothèse, la mise en scène, avec son noir brutal et la venue de son générique, ne serait alors à prendre que comme une figure de style à même d’instaurer une fin ouverte par-dessus une fin fermée. Simple et faussement complexe, comme souvent avec Nolan.
L’explication n° 3 en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=XkdDHy9E8aU&t=7s
Dans cette troisième explication, grâce à une astuce trouvée par un internaute qui aime sans doute un peu trop le réalisateur de The Dark Knight, on apprend que Cobb retrouve bien ses ‘‘vrais’’ enfants lors de la séquence finale du film. En effet, si l’on observe très (très) attentivement, on remarque que le personnage joué par Leonardo Dicaprio ne met pas sa bague de mariage lorsqu’il se trouve dans la réalité, et qu’à l’inverse, il la porte dans le monde des rêves. Derrière la révélation, le plus beau reste le sens apporté par ce mécanisme servant de distinction entre deux univers, et par delà, deux états psychologiques. Le premier voit Cobb libéré de la mort de sa femme, tandis que le second le laisse encore attaché à ce traumatisme.
[nextpage title=”Le film le plus complexe de tous les temps ?”]
Primer (2004)
L’histoire : Dans une banlieue américaine, à l’intérieur d’un garage, deux ingénieurs, Abe et Aaron, développent secrètement une machine capable de réduire la masse des objets. Mais ils ne vont pas tarder à découvrir une fonction inattendue de l’engin. Celui-ci pourrait servir à revenir dans un passé proche. Les deux hommes décident alors d’en tester les effets sur eux-mêmes pour notamment gagner à la bourse. Si le procédé temporel s’avère bel et bien fonctionnel, les vies d’Abe et Aaron s’en retrouvent cependant bouleversées. La faute à d’infimes variations temporelles provoquées par l’utilisation de la machine.
L’explication : ‘‘Perso, j’ai rien compris (…) hyper confus comme film, un des plus hard que j’ai regardés jusqu’à maintenant, on perd tous ses repères.’’, ‘‘Il entre dans la catégorie des films qu’il faut voir mais surtout revoir car chaque scène, chaque dialogue peut avoir une signification différente lors du second visionnage...’’ peut-on lire sur certains espaces de discussions en ligne dédiés à Primer, premier long métrage de Shane Carruth réalisé pour seulement 7000 dollars. Une prouesse ahurissante, tant sur le plan technique qu’intellectuel. Comprendre le film est d’ailleurs un petit défi en soi, tant il se relève être sophistiqué dans son écriture. L’utilisation dans les dialogues d’un jargon scientifique et mathématique ajoute par exemple une touche d’hermétisme rare dans une œuvre cinématographique.
Il y est notamment question d’entropie, de thermodynamique ou encore de diagramme de Feynman. Bref, si vous n’avez pas un Master en sciences ou une affinité particulière avec ces sujets, il vous sera pratiquement impossible de cerner dans sa globalité Primer. Cependant, ces éléments font seulement preuve de background apte à crédibiliser l’intrigue et la notion de voyage dans le temps. Le challenge essentiel se situant quant à lui dans le discernement même de ce qui est raconté à l’écran. Du fait que Shane Carruth joue volontairement sur les différentes timelines et les doubles de Aaron et Abe sans jamais prendre le spectateur par la main, et ce en essayant de respecter une conceptualisation du voyage temporel réaliste (c’est à dire aux antipodes de Doctor Who), il devient très vite ardu de s’y retrouver. Tellement ardu qu’il apparaît ici impossible d’expliquer l’entièreté de l’œuvre, tant il faudrait en pratiquer une analyse poussée et précise.

En dehors du schéma ci-dessus, le récit de Primer se capture en y plaçant devant toute son attention. Et de préférence en prenant des notes. Il y a ainsi au moins une notion à assimiler avant de se lancer dans l’expérience. Cette dernière concerne la question du voyage dans le temps. Contrairement à d’autres films comme Retour vers le futur ou Terminator, celui de Shane Carruth décide d’une règle originale qui se résume de la sorte : pour qu’un personnage puisse retourner dans le passé, mettons de 24 heures, il doit passer autant de temps dans la machine. Indéniablement de la hard science-fiction de haute volée.
Enfin, tout juste peut-on condenser l’histoire Primer en quelques mots, en épurant considérablement ses enchevêtrements narratifs : l’histoire de deux amis ingénieurs qui, suite à leur expérimentation du voyage dans le temps et leur volonté de s’enrichir, vont finir par payer le douloureux prix de leur ambition. Une intrigue à la morale finalement classique qui se résume de la sorte : à jouer à Dieu, on finit toujours par se brûler les ailes.
Ces films surréalistes, déroutants et/ou complexes sont absents mais on aurait aussi pu en parler :
- 2001 : l’odyssée de l’espace de Stanley Kubrick
- Solaris de Andreï Tarkovski
- Lost Highway de David Lynch
- Cube de Vincenzo Natali
- Pi et Mother de Darren Aronofsky
- Donnie Darko de Richard Kelly
- Ghost in the shell 2 : Innocence de Mamoru Oshii
- Upstream color de Shane Carruth
- Synecdoche, New York de Charlie Kaufman
- Enemy de Dennis Villeneuve
- Et bien d’autres…
🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités et sur notre WhatsApp. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.












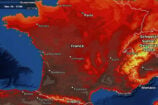







"Seulement chez le co-créateur de Twin Peaks, tout a un sens" désolé mais cette phrase m’a fait bondir. suffit de voir Inland Empire ou la dernière saison de Twin Peaks pour voir à quel point c’est faux.
Sinon sympa le dossier 😀
L’auteur semble maitriser à la perfection son sujet. A priori, il n’a du voir que le seul Mulholland Drive de Lynch.
On dirait que vous avez fait de bonnes études dans la Grande école européenne des ****** />
Sinon sympa le commentaire 😀