Un virus informatique frappe soudainement l’ensemble des États-Unis, créant une panne générale de tous les réseaux pendant une minute. Une minute pendant laquelle les avions volent à l’aveugle, les feux de signalisation ne répondent plus ou les métros ne communiquent plus. L’attentat, non revendiqué, fait des milliers de morts et une promesse : ce n’est que le début. Face à la panique, la présidente des États-Unis met en place une commission extraordinaire disposant des pleins pouvoirs, sans respect de la Constitution, afin de trouver les responsables du « Zero Day » et d’empêcher une nouvelle catastrophe. Une commission placée entre les mains de l’ex-président George Mullen.
Pour jouer George Mullen, on retrouve un Robert De Niro toujours aussi pro-actif dans sa carrière, capable de mélanger les torchons et les serviettes entre comédie bas du front et projets taillés davantage à la mesure de la légende de 81 ans. Et sur le papier, il faut reconnaître que cette mini-série en six épisodes semblait appartenir à la seconde catégorie. D’autant que le casting ne s’arrête pas au bonhomme et compte dans ces rangs des noms comme Jesse Plemons (Civil War), Connie Britton (Friday Night Lights), Lizzy Caplan (Masters of Sex), Angela Bassett (Black Panther), Dan Stevens (Légion) ou encore Clark Gregg (Avengers). Excusez du peu !
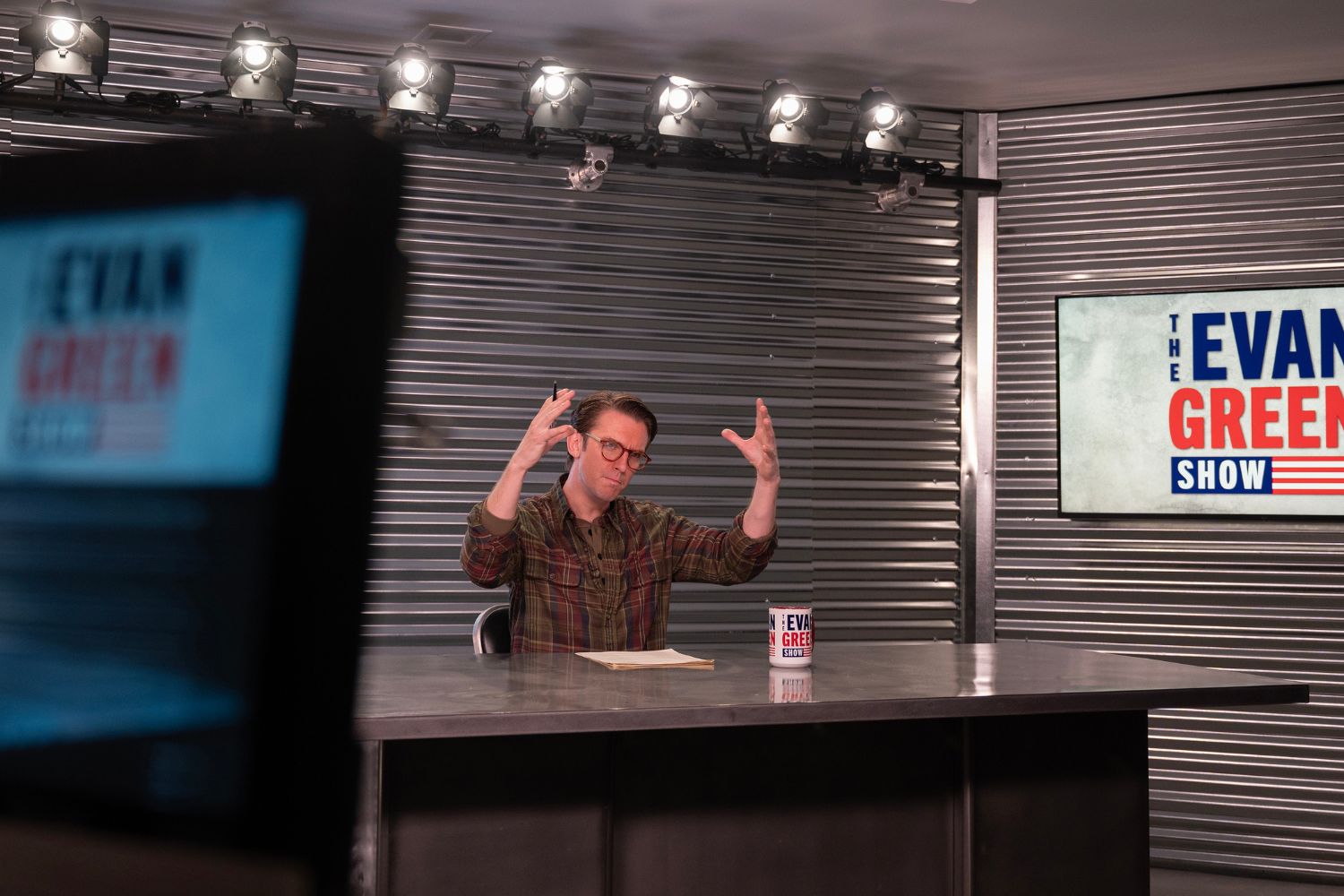
Second argument pour nous convaincre d’appuyer sur lecture : un scénario qui résonne dans l’actualité avec une Amérique divisée et fragilisée, dont il ne manquerait qu’une étincelle pour transformer le pays en guerre civile. Une étincelle que les lanceurs d’alerte adeptes de la théorie du complot allumeraient bien. À une époque où les fake news ou autres deepfakes inondent les réseaux sociaux et où Trump et Musk courent dans les couloirs de la Maison Blanche, le bras tendu et le briquet à la main, Zero Day semble arriver à point nommé pour surfer sur la vague de la défiance et de la morale sans forcément faire un choix.
Zero Day, zero risque
Sauf que Zero Day se devait aussi de surmonter un obstacle majeur, celui du secteur hautement embouteillé du thriller politique. Rien que dans nos expériences récentes, la série Paradise sur Disney+ épouse le genre avec une certaine générosité, et même Marvel tente de s’y accrocher en salles avec son Captain America : Brave New World de pâle figure. Deux exemples parmi tant d’autres, l’actualité étant, certes, source d’intérêt du spectateur, mais également d’idées de scénario fournies par ChatGPT. Le fameux concept de l’offre et la demande facilité par ce qui nous entoure. Et pour parvenir à se démarquer de la masse, il fallait compter, ici, sur un récit écrit à six mains ; celles d’Eric Newman (la série Griselda sur Netflix), de Noah Oppenheim (Divergente 3) et de Michael Schmidt (première expérience à ce poste).

Et c’est là que les problèmes commencent. Une fois passé le premier épisode d’amorce, le récit va cumuler les poncifs du genre en enchaînant les révélations et les mystères sur un rythme lancinant. Le fil rouge repose sur les habituelles questions autour de qui a trahi qui et de quel secret se cache derrière telle découverte. Zero Day fait preuve d’un classicisme scolaire et l’ennui n’est jamais bien loin de nous étreindre par l’absence de surprises. Les réponses ayant été données par tous les shows ayant précédé celui-ci.
Toutefois, cette mini-série aurait pu s’en sortir convenablement, se contentant du célèbre « sympa, mais oubliable » de beaucoup de productions de la plate-forme, si le cahier des charges avait encore été correctement appliqué. Non, plus l’intrigue et les épisodes avancent, plus il devient clair que notre trio de créateurs ne sait absolument pas comment traiter les multiples éléments implantés. On peut même supposer le pire : que chacun ait écrit sa partie sans se concerter avec les autres. On ne saurait vous donner trop d’exemples détaillés sans divulgâcher, néanmoins, sachez qu’ils partagent un bon commun : arriver à point nommé dans l’histoire, puis disparaître avant d’être simplement évoqués par la suite.
Trop long pour ce que ça raconte, trop court pour ce que ça veut raconter
Plusieurs parties de l’intrigue vont, notamment, tourner autour d’un appareil de ciblage ou d’un oligarque avant qu’ils ne soient balayés d’un revers de la main. On a le sentiment que les épisodes communiquent mal entre eux. Le comble pour une série centrée sur la recherche de réponses, qui fait frontalement fi de ces mêmes réponses dès lors que le scénario décide de passer à l’étape suivante. Comme s’il y avait eu de nombreuses coupes entre l’écriture du script et le montage final.
Une impression de manque qui transpire dans l’utilisation des personnages dont beaucoup disparaissent de la scène bien trop vite et sans conséquence. Un constat appuyé par ce dont nous vous parlions en préambule : Zero Day a fait appel à un casting particulièrement costaud, mais dont chacun a si peu à jouer ou à développer qu’il paraît clair que des scènes ont été coupées. À moins que ce soit simplement écrit avec les pieds, ce n’est pas à exclure.

On a donc une série paradoxale qui prend trop son temps pour nous délivrer un récit convenu, là où un film de deux heures aurait pu s’en sortir et être davantage pardonnable en nous épargnant les quatre heures de surplus ; mais, dont il apparaît qu’il manque des gros morceaux à ce même récit pour le rendre plus consistant. Autrement dit, voilà six heures bien mal exploitées.
Et Robert De Niro dans tout ça ? Il a bien conscience que ses camarades jouent la montre et que tout le reste repose sur ses épaules. Dès lors, on ne lui enlèvera pas qu’il essaie de se montrer à la hauteur des responsabilités. Cependant, tout le sérieux de la posture mis à part, il trimballe surtout l’expression faciale figée d’un homme assommé qui n’a pas envie de donner plus que ce qu’on lui demande. Et ce ne sont pas les multiples gros plans de la réalisatrice Lesli Linka Glatter, chargés d’appuyer la stature du personnage et de l’acteur (il faut bien justifier le chèque), qui viendront nous convaincre qu’un De Niro se cache derrière ce Robert.
Tel un ultime coup de couteau dans la plaie, Zero Day se paie le luxe d’annoncer vouloir égratigner les gouvernants ou les extrêmes de chaque bord au sein du peuple, mais constamment en lissant son propos, en arrondissant chaque angle. Comme si dans ce thriller politique, elle s’était prioritairement concentrée sur le politique en prenant bien soin de ne froisser aucun bord, aucun des millions d’abonnés Netflix. Du coup, on dénonce, mais pas trop quand même. Car après tout, pour citer Michel Jordan : « Les Républicains achètent aussi des baskets ».
🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités et sur notre WhatsApp. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.










