Tout réussi décidément à Wes Anderson. Après le triomphe de The Grand Budapest Hotel (quatre oscars tout de même), voilà que l’américain remporte l’Ours d’Argent du meilleur réalisateur pour L’Île aux Chiens. Un film qui marque son retour à l’animation, genre où il a déjà su combiner ses obsessions esthétiques tout en explorant des thématiques qui lui sont chères. Il réitère aujourd’hui avec une œuvre au ton plus grave, mais conserve la maîtrise de chaque image.
En s’appuyant sur la menace d’une grippe canine, le maire de Megasaki ordonne que tous les chiens de la ville soient mis en quarantaine sur une île pleine de déchets. Du haut de ses douze ans, Atari décide alors d’aller chercher Spots, son fidèle compagnon. Il rencontre un groupe de cinq chiens au caractère bien trempé, qui vont l’aider à le retrouver tout en déjouant une conspiration de grande ampleur.
La mise en scène de Fantastic Mr Fox impressionnait, celle de L’Île aux chiens subjugue. À moins d’être réfractaire à ce style d’animation, difficile de ne pas constater la finesse du travail d’Anderson. Image par image, à raison de 24 par secondes, le réalisateur créé un monde fascinant.
Dominée par des tons ocre et grisâtres, la photographie laisse une nouvelle fois entrevoir le soin maniaque apporté à la symétrie des plans. Anderson jongle aussi avec les reliefs et l’impression de passer constamment de la deuxième à la troisième dimension est prégnante.
Ce travail d’orfèvre se révèle alors être un challenge de tous les instants pour ceux qui voudront le décrypter. L’occasion de constater que les idées les plus simples sont parfois les plus efficaces. On s’étonne devant le charme fou d’un nuage de fumée en boule de coton ou d’un coucher de soleil peint à l’aquarelle.
Le récit se déroulant sur l’archipel nippone, Anderson en profite pour livrer un vibrant hommage à la culture japonaise. On reconnait, ici et là, la “Grande Vague de Kaganawa” ou des personnages de Kabuki, en pensant évidemment à l’impact de Kurosawa sur la cinématographie générale.
L’ouïe est autant mise à contribution que la vue. L’orchestration d’Alexandre Desplat, basée principalement sur des percussions, sert habilement un montage plus frénétique que d’habitude.
Requiem visuel, L’Ile aux chiens se veut aussi être une fable. Via l’exclusion des canidés, souvent présenté comme le meilleur ami de l’homme, Anderson laisse infuser une réflexion sur l’intolérance et la peur de l’autre. Plus politique que d’habitude, son film fait évidemment penser à l’échauffement diplomatique de l’Amérique trumpiste même si les USA ne sont pas uniquement visés.
Habitué des questionnements liés à l’enfance et au souvenir, Anderson n’est pas un cinéaste sulfureux. Si bien que l’on aurait peut-être aimé encore plus de radicalité dans son propos, quitte à faire une erreur. Une remarque qui s’applique à une bonne partie de sa filmographie, dont le maniérisme et la douceur écrasent parfois la narration. Sa recherche de la perfection visuelle absolue semble en effet étouffer l’émergence d’une idée inattendue, pouvant mettre à mal son univers parfaitement ordonné.
L’américain se rattrape en revanche en tissant une belle amitié entre les chiens et leur compagnon d’infortune. Le casting exceptionnel, composé de Byan Cranston, Edward Norton, Bill Murray ou encore Scarlett Johansson y joue pour beaucoup. Cela devrait également être le cas pour leur équivalent français, choisi par Anderson lui-même.
Si le dénouement prend peut-être un peu trop son temps, il se révèle touchant. À l’image de cette scène de transplantation d’organe entre homme et canidé, Anderson veut croire en une égalité complète entre les êtres vivants. Énième variation des thèmes qui l’obsède, L’Île aux chiens diffuse une nouvelle fois son soft power jusqu’à ce que l’on y cède.
🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités et sur notre WhatsApp. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.







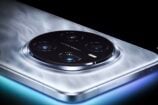






A partir de quel âge ? C’est plutôt adulte ou bien un enfant peut y trouver son compte ?