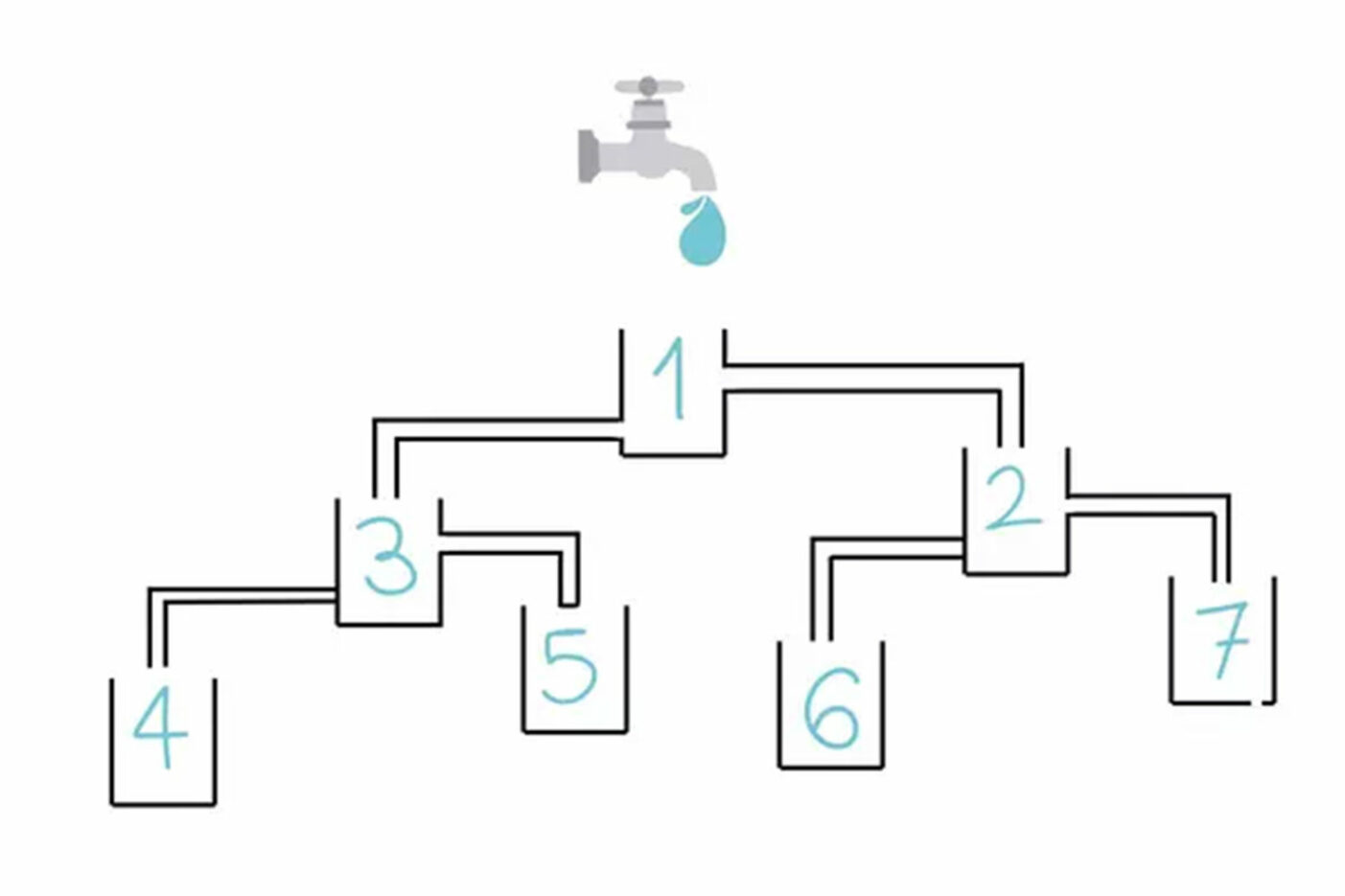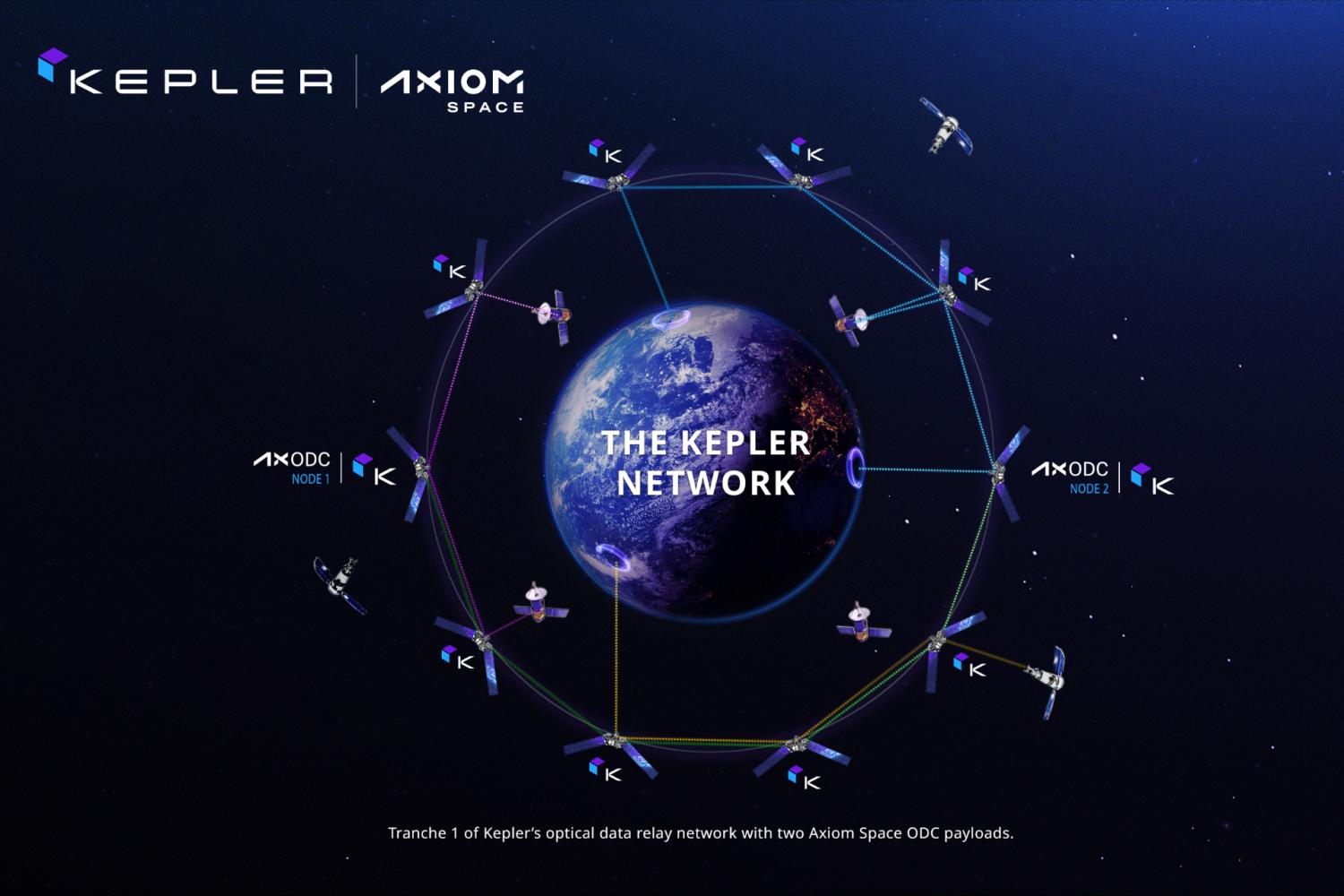Les fans de The Last of Us sont dans les starting blocks en ce moment, avec la sortie de la deuxième saison inspirée du blockbuster de Naughty Dog. L’intrigue de ces deux œuvres est en grande partie inspirée du Cordyceps, une famille de champignons parasites tout ce qu’il y a de plus réels capables de « zombifier » leurs hôtes pour en prendre le contrôle.
Puisque nous nous sommes déjà attardés sur le fonctionnement des vrais Cordyceps dans un précédent article, pour fêter la sortie de cette deuxième saison, nous vous proposons cette fois une petite collection d’autres espèces de parasites. Ceux-ci ont développé des stratégies parfois dérangeantes, mais toujours fascinantes pour atteindre leur hôte de prédilection. Âmes sensibles s’abstenir !
L’imposteur ultime
Premier arrêt : le papillon japonais Niphanda fusca. Pour se reproduire, cette espèce a développé une stratégie fascinante qui consiste à exploiter une structure sociale tout entière !
Cet insecte commence par pondre ses œufs sur une plante, afin que sa progéniture puisse se nourrir de ses bourgeons. Mais ces larves n’ont pas l’intention de se contenter de ce régime. Il s’agit surtout d’une manière de temporiser en attendant l’arrivée de ses vraies cibles : les fourmis.

Lorsqu’elles arrivent à maturité, les larves commencent à sécréter un composé qui imite la signature chimique de Camponotus japonicus, une espèce de fourmi originaire du pays du Soleil levant. Ces dernières, convaincues d’être tombées sur un rejeton égaré, s’empressent donc de le ramener au sein de leur nid.
À partir de ce moment, la larve va être dorlotée par la colonie tout entière, qui va se charger de la nourrir et de la protéger sans même réaliser qu’il s’agit d’un intrus. Les fourmis ne réalisent pas qu’il s’agit d’une supercherie avant l’émergence du papillon adulte, qui est alors libre de prendre la poudre d’escampette avant même que ses hôtes aient compris qu’elles avaient été bernées. Un incroyable exemple de parasitisme et même d’ingénierie sociale qui permet au papillon de se reproduire efficacement sans faire la moindre victime.
Le ver qui fait danser les yeux
Mais tous les parasites ne sont pas aussi inoffensifs — et ce n’est certainement pas le cas de Leucochloridium paradoxum, un membre de la famille des vers plats, ou plathelminthes. Leur cycle de vie commence lorsqu’un pauvre escargot déguste ses œufs, sans réaliser qu’il s’agit en fait de redoutables chevaux de Troie. Peu après ce repas, les œufs commencent à grandir dans les entrailles du gastéropode. Ils finissent par donner naissance à des miracidium — des larves spécialisées, capables de se déplacer sans peine dans des environnements aqueux… comme l’hémocoele, la cavité remplie de liquide dans laquelle baignent les organes des mollusques.
Grâce à ces capacités, les larves prennent la direction d’une glande digestive, l’hépatopancréas. Après y avoir pénétré, elles entament une nouvelle transformation, cette fois en sporocystes — des structures spécialisées dans la dissémination d’objets associés à la reproduction, comme des spores. Et c’est là que l’histoire prend un tournant assez spectaculaire.
Au lieu de se frayer un chemin vers l’extérieur de l’escargot pour disséminer cette progéniture, les sporocystes commencent à produire des sacs à couvain colorés, pulsatiles et surtout remplis de larves. Ils s’infiltrent ensuite dans les antennes qui portent les yeux, les faisant gonfler massivement. À ce stade, ces appendices ressemblent donc à s’y méprendre à des chenilles hyperactives.
En parallèle, le parasite reprogramme aussi le système nerveux de son hôte. Un peu à la manière des Cordyceps, il le pousse à escalader la végétation. L’objectif : exposer ces « chenilles » à d’éventuels prédateurs… et notamment aux oiseaux, derniers hôtes de Leucochloridium paradoxum. Incapables de résister à ce casse-croûte si alléchant et servi sur un plateau, les volatiles se ruent donc sur les antennes du pauvre escargot, ingérant ainsi les larves et perpétuant le cycle de vie du parasite. Il y a toutefois une bonne nouvelle : les antennes des escargots étant capables de repousser, la victime s’en sort souvent indemne… et n’a plus qu’à toucher du bois pour ne pas être infectée une seconde fois.
L’épouvantail zombie
Lorsqu’on parle de parasites, on pense souvent à des virus, à des vers ou encore à des champignons. Mais le parasitisme joue aussi un rôle central dans le cycle de vie de nombreuses espèces plus inattendues, et notamment des guêpes comme celles du genre Glyptapanteles. Une fois leurs œufs fertilisés, ces dernières s’attaquent à une chenille sans défense, qui va malgré elle être promue au rang d’épouvantail pour la progéniture de l’assaillant.
La guêpe commence par injecter ses œufs directement dans l’hémolymphe (l’équivalent fonctionnel du sang chez ces insectes) de sa victime. Après avoir éclos, les larves se mettent alors à dévorer les organes internes de leur hôte, en prenant bien soin d’éviter toute structure vitale. Elles sécrètent également des immunosuppresseurs qui les aident à se développer sans être dérangées.
Un peu plus tard, les larves se mettent à sécréter une autre substance qui altère le comportement de la chenille. Cette dernière — ou plutôt ce qu’il en reste — commence à s’isoler, et se comporte de manière agressive. Quand les parasites sont enfin arrivés à maturité, ils s’extraient du corps de la chenille pour aller former un cocon (ou plus précisément une pupe), occasionnant des blessures sérieuses au passage.

Mais l’hôte n’est pas encore tout à fait mort à ce stade. Une étude de chercheurs néerlandais a montré qu’ une poignée de larves a tendance à rester à l’intérieur de la victime zombifiée pour continuer à la “piloter”, afin de s’assurer qu’elle passe le reste de sa vie à monter la garde malgré elle. Sa seule et unique mission : protéger les pupes d’éventuels prédateurs, comme les fourmis, jusqu’à l’émergence des jeunes guêpes… qui vont immédiatement se mettre en quête de nouvelles chenilles pour perpétuer ce cycle morbide.
L’incubateur vivant
Tous les parasites cités jusqu’à présent exploitent des cibles relativement inoffensives, surtout lorsqu’elles sont isolées. Mais d’autres animaux sont aussi capables de s’attaquer à des espèces qui, à première vue, semblent parfaitement équipées pour se défendre. C’est le cas de Sacculina carcini, qui s’attaque aux crabes — avec des conséquences qui font décidément froid dans le dos.
Tout commence avec une petite larve qui nage librement dans une zone peuplée de crustacés. Lorsqu’elle a identifié sa cible, elle procède à une attaque à la précision chirurgicale. Au lieu de chercher à percer sa carapace, elle vise une des rares zones exposées, à l’intersection des plaques de chitine qui constituent une armure impénétrable pour de nombreux prédateurs.
Plus spécifiquement, la larve profite de cette vulnérabilité pour y injecter une petite masse de cellules, le vermigon, qui va devenir le véritable parasite. Ce vermigon va croître à l’intérieur du crabe sous forme de tentacules qui vont infester toute son anatomie interne… et notamment ses organes reproducteurs, qui sont au cœur de la stratégie de Sacculina carcini.
Le premier effet est de stériliser l’hôte, qui ne sera plus jamais capable de se reproduire. À partir de là, le parasite fait pousser des excroissances remplies de parasites juvéniles, qui émergent au niveau de l’abdomen — exactement là où un crabe femelle porterait ses propres œufs ! Par conséquent, le crustacé en prend soin comme s’il s’agissait de sa propre progéniture.

Et s’il s’agit d’un mâle, qu’à cela ne tienne — il suffit de le transformer en hôte idéal ! Des chercheurs allemands ont montré dans une étude qu’au lieu d’abandonner le crabe, le parasite sécrète des hormones féminisantes qui poussent le crustacé à abandonner la recherche d’une compagne, et à se comporter comme une femelle en train de protéger ses rejetons.
Une fois les larves matures, les excroissances se rompent, relâchant une myriade de larves matures qui vont partir à la recherche d’une nouvelle victime. Le pauvre crabe, en revanche, reste stérile… et extrêmement vulnérable, car privé de sa capacité à muer pour remplacer sa carapace. À terme, cet incubateur vivant est donc condamné à une mort certaine dans cet écosystème impitoyable.
Le greffon vivant
Et si la méthodologie de Sacculina carcini n’était pas encore assez cauchemardesque pour vous, Cymothoa exigua va sans doute remporter la palme. Celui-ci ne se contente pas de pirater le cerveau de son hôte ou de le dévorer de l’intérieur : à la place, il s’installe durablement en remplaçant un organe particulièrement sensible.
Tout commence avec une larve d’isopode, une sous-catégorie de crustacé qui contient notamment les cloportes. Lorsqu’elle rencontre un hôte potentiel, souvent un poisson de la famille des vivaneaux, elle s’infiltre par les branchies pour se fixer à proximité d’un vaisseau sanguin. Une source d’alimentation parfaite, qui va lui permettre de grandir tranquillement en attendant de passer à la prochaine étape de son plan.

Une fois suffisamment massif, l’isopode migre vers la bouche du poisson et se fixe à la base de sa langue. Cette étreinte a pour effet de couper la circulation sanguine ; l’organe se met donc à s’atrophier jusqu’à mourir complètement et à tomber. Le parasite se déplace alors une dernière fois pour se fixer sur le moignon… et remplace physiquement la langue ! Il peut ainsi vivre pendant de longues années en se nourrissant aux dépens de son hôte, qui en devient totalement dépendant suite à cette amputation. Un stratagème sacrément élaboré; au fil de l’évolution, Sacculina carcini a même acquis une forme comparable à celle de la langue de ses victimes afin qu’il puisse continuer à se sustenter, pour le plus grand plaisir de l’affreux passager.
🟣 Pour ne manquer aucune news sur le Journal du Geek, abonnez-vous sur Google Actualités et sur notre WhatsApp. Et si vous nous adorez, on a une newsletter tous les matins.